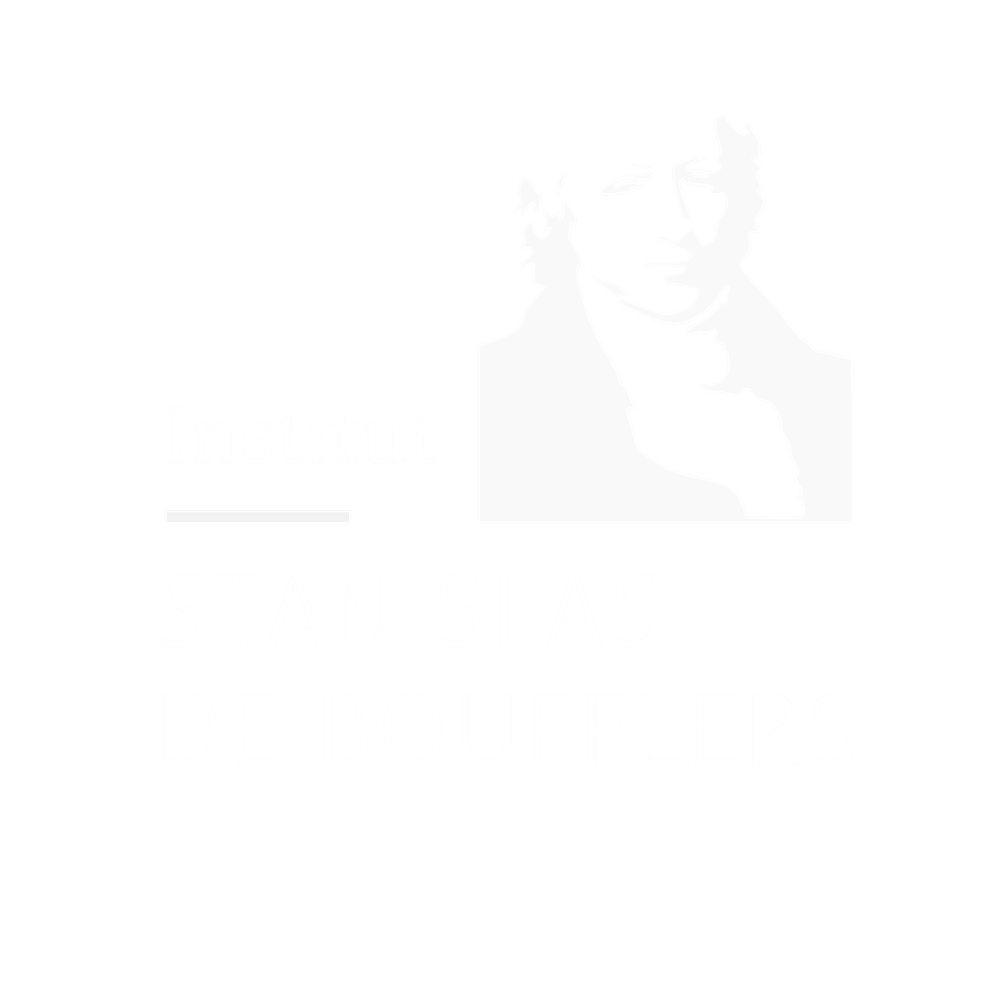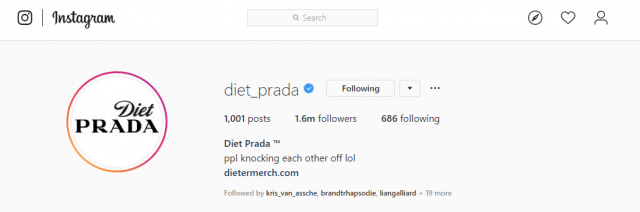
L’affaire a fait du bruit dans la presse généraliste. Depuis bientôt deux ans, la chaîne Youtube Copycomic, dont l’auteur reste anonyme, diffuse des vidéos pointant les ressemblances entre des sketches d’humoristes. On observe un phénomène comparable dans l’univers de la mode avec le compte Diet Prada, qui s’est spécialisé dans la dénonciation des ressemblances entre créations stylistiques. Le procédé de Copycomic, lui, consiste à comparer des séquences de spectacles d’humoristes – principalement dans l’univers du stand up – pour en souligner les ressemblances et dénoncer l’appropriation illégitime faite par certains de ces humoristes, qui jouissent en général d’une très grande notoriété. L’accumulation des séquences, soulignée par la maîtrise du montage, des parallèles opérés, est saisissante… Au-delà de cette appréciation spontanée, qu’en penser d’un point de vue juridique ? Sous des apparences anodines, il nous semble que l’affaire Copycomic est très révélatrice d’un nouvel ordre moral instauré par les réseaux sociaux, ordre qui déplace les termes qu’un débat juridique traditionnel poserait.
À première vue, on pourrait se réjouir que les réseaux sociaux viennent dénoncer des atteintes au droit d’auteur… On est plutôt habitué, depuis une quinzaine d’années, à ce que ces outils véhiculent des contenus contrefaisants, en permettant un partage en masse de contenus protégés, sans autorisation. Dans cette lignée, et à l’inverse de ce qui est communément observé en la matière, il semblerait que l’opinion publique penche ici plutôt du côté des auteurs premiers des œuvres. Copycomic valorise ainsi a priori la personne du créateur, en soulignant l’importance du travail de création et la reconnaissance de la paternité de celui-ci.
Le procédé repose d’ailleurs en creux sur l’idée que le droit moral de l’auteur (protection de la paternité et de l’intégrité de l’œuvre) et ses droits patrimoniaux (ici l’interdiction de copier sans autorisation) protègent aussi indirectement le public en lui assurant la provenance des créations qu’il reçoit. C’est là une fonction qui relève plutôt du droit des marques, droit qui vise à permettre la distinction des produits les uns par rapport aux autres. Non traditionnelle pour le droit d’auteur, cette fonction d’identification et d’intangibilité des œuvres ne lui est toutefois pas totalement étrangère et elle souligne les liens intrinsèques qui se nouent entre la protection de la personne de l’auteur et les intérêts du public. La viralité du phénomène Copycomic semble montrer que cette fonction est intuitivement perçue par le public.
Pour autant, le procédé n’est pas exempt de critiques. La dénonciation repose sur l’émotion que peut susciter le rapprochement de deux séquences similaires pour le public. Il s’agit là d’une condamnation morale, et non d’une analyse juridique. Pour se prononcer sur le caractère contrefaisant des reprises dénoncées, il faudrait nécessairement avoir un recours à un juge ; la complexité du raisonnement de ce dernier montre que la seule vision des séquences et la perception rapide que l’on peut en avoir ne permettent pas de trancher.
Un juge s’interrogerait d’abord sur le caractère protégeable de l’élément repris. En droit d’auteur, est protégée une forme originale. La forme se distingue de la simple idée, de libre parcours. Ainsi, la reprise de l’idée sous-jacente à une blague est en soi libre. Or, première difficulté, le stand up est un univers humoristique qui répond à des codes particuliers, suivant lesquels l’humoriste s’adresse directement, debout, sans personnages ni décors, au public, pour le faire rire, le prendre à partie, en créant une connivence. Il s’agit notamment de rire sur des observations de la vie quotidienne, sur ses absurdités. C’est ainsi que, nécessairement, les mêmes thèmes reviennent de manière récurrente. On ne peut donc reprocher à deux artistes de traiter, au hasard, de la peur en avion. Il s’agit là, du point de vue du droit d’auteur, d’une idée non protégée. En revanche, la forme que va prendre l’idée, donc la formulation précise de la blague, si elle est en outre révélatrice de la personnalité de celui qui la crée, peut faire prise au droit d’auteur. À ce titre, la brièveté n’étant pas un critère de (non) protection, une simple phrase peut être protégée par le droit d’auteur ; à l’inverse, une longue séquence peut ne pas être protégée si, par exemple, elle est considérée comme banale. Par ailleurs, le droit français ayant une approche particulièrement compréhensive des œuvres susceptibles de protection, il est possible d’envisager que les mimiques, les gestes précis utilisés par un acteur soient également protégés, pour eux-mêmes, ou en combinaison avec les termes utilisés. Ainsi, dans une séquence humoristique, l’objet même de la protection par le droit d’auteur peut en soi faire naître un débat compliqué qui mérite plus que la superposition de séquences similaires.
Ensuite, pour déterminer s’il y a contrefaçon, le juge doit, dans un second temps, comparer la séquence originelle avec la séquence litigieuse. Il lui faut alors déterminer si ce qui est repris permet de retrouver l’œuvre première. Si seule l’idée est reprise – se moquer de la peur de l’avion – la reprise n’est pas contrefaisante, quand bien même l’œuvre première serait protégée. Si des éléments de forme originale sont perceptibles dans la seconde création, il aurait fallu demander l’autorisation à l’auteur de l’œuvre première – qui, d’ailleurs, peut ne pas être celui qui dit le texte…
Aussi, la réappropriation d’une blague avec une nouvelle mise en scène – attitude ou gestuelle différentes – peut, suivant les cas, correspondre à diverses qualifications juridiques. Une reprise telle quelle constitue un acte soumis au droit d’auteur – et donc à autorisation – si la séquence reprise est elle-même protégée. Une reprise modifiée pourrait entrer dans le cadre d’une œuvre dérivée – transformatrice – ce qui suppose donc là encore une autorisation de l’auteur de l’œuvre première, sauf si la reprise est suffisamment éloignée pour qu’on ne retrouve pas les traits caractéristiques et originaux de l’œuvre première. Enfin, dans l’hypothèse où seule l’idée brute est reprise – par exemple faire un sketch sur la peur de l’avion – le second artiste est libre de le faire sans demander aucune autorisation au premier. Il y a donc une gradation de qualifications envisageables, qui suppose une maîtrise de la technique juridique dont seul un juge – éventuellement aidé d’un expert – est véritablement capable. En outre, le courant jurisprudentiel actuel, incarné pour le droit d’auteur par l’arrêt Klasen (Cass. civ. 1ère, 15 mai 2015, n° 13-27391), qui repose sur la mise en balance des intérêts entre, d’une part, la protection des auteurs, et, d’autre part, la liberté de création, complique encore plus l’appréciation. L’analyse classique repose sur la mise en œuvre du syllogisme juridique : identification de la majeure, à savoir ici le fait que toute reproduction et/ou représentation d’une œuvre de l’esprit suppose l’autorisation de l’auteur de celle-ci / identification de la mineure, soit ici le constat d’une reprise d’éléments préexistants par un second humoriste / conclusion. L’analyse renouvelée de la mise en balance des intérêts fait entrer dans le raisonnement du juge un faisceau d’indices plus complexes, une appréciation plus subjective et empêche donc toute prédiction de la conclusion.
Par ailleurs, le droit d’auteur connaît des bornes internes, les exceptions aux droits patrimoniaux. On songe, en cas de reprise d’une blague, à l’exception de courte citation. La courte citation, si elle est plutôt pensée à l’origine pour les œuvres littéraires pourrait être mise en œuvre dans le cadre d’un spectacle, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions précises. Tout d’abord la brièveté de la citation, ce qui s’évalue au regard de l’œuvre citante et de l’œuvre citée et suppose donc de déterminer, déjà, les bornes de l’œuvre : le spectacle ? le sketch ? la blague ? Ensuite, la finalité de la citation. Enfin, il est nécessaire de respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre citée, ce qui suppose, notamment, en principe de faire figurer son nom. Certes, les conditions de la courte citation sont peu probablement réunies dans de telles circonstances mais il appartient à un juge de le déterminer.
Or jusqu’ici, à notre connaissance, aucun auteur n’a soulevé l’argument juridique de la contrefaçon et n’a semblé vouloir assigner qui que ce soit en contrefaçon. Le débat a porté sur la légalité des vidéos de dénonciation elles-mêmes et, en tout état de cause, c’est Twitter qui a décidé et tranché : les tweets dénonçant les reprises ont disparu un temps – l’humoriste mis en cause s’est défendu en invoquant les droits voisins sur ses vidéos, ce qui montre que le débat n’est pas à un paradoxe près – puis ont été à nouveau placés en ligne. Indirectement, ce sont donc les intermédiaires techniques qui sont placé en situation de trancher un débat censément juridique ce qui, en toute rigueur, ne leur appartient pas, mais leur est dévolu du fait de l’importance des réseaux sociaux. La remise en ligne des vidéos de dénonciation ne tranche certes pas le débat de fond sur la contrefaçon mais c’est néanmoins, dans ce contexte très particulier, une forme de jugement sur la légitimité des reproches adressés.
En définitive, ce sont les intermédiaires techniques et le public qui, d’une manière différente, sont confrontés à un débat qui les dépasse nécessairement et ne leur appartient pas. D’ailleurs, sait-on exactement quels sont les termes du débat ? S’agit-il de demander une réparation de la supposée contrefaçon ? D’obtenir un retrait des passages litigieux de vidéos accessibles (en ligne, en format DVD) ? Rien n’est formulé très clairement. L’absence d’action judiciaire de la part d’artistes dénonçant la contrefaçon est révélatrice d’un malaise des auteurs à défendre leurs créations. Le like, le tweet et le retweet se substituent au juge de paix. Cela dit, en creux, quelque chose sur la place de la défense de la création dans notre société, notamment depuis l’apparition du numérique et les tentatives souvent maladroites de lutter contre la contrefaçon massive en ligne, et sur la place qu’ont réussi à occuper les réseaux sociaux dans la sphère publique. L’artiste qui défend la protection de ses œuvres doit justifier de la légitimité de son combat, alors même que la loi le protège. Paradoxalement, la voie du droit lui étant socialement difficilement accessible, c’est finalement sur le terrain de la morale qu’il se place, avançant souvent masqué et en tentant de renverser l’opprobre sociale contre celui qui copie. On peut comprendre la démarche ; elle ne nous semble toutefois par heureuse et l’on peut craindre les dérives. Malgré ses lourdeurs, seule la tenue d’un procès est propice à la tenue d’un débat à la hauteur des questions soulevées. Le principe du contradictoire est le seul à permettre d’entendre chacune des parties et à avoir une approche plus nuancée de la situation que la seule vision d’une vidéo percutante ne le permet.
Sarah Dormont
Maître de conférences à l’Université Paris Est Créteil
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leurs auteurs et ne sauraient refléter la position de l’Institut.